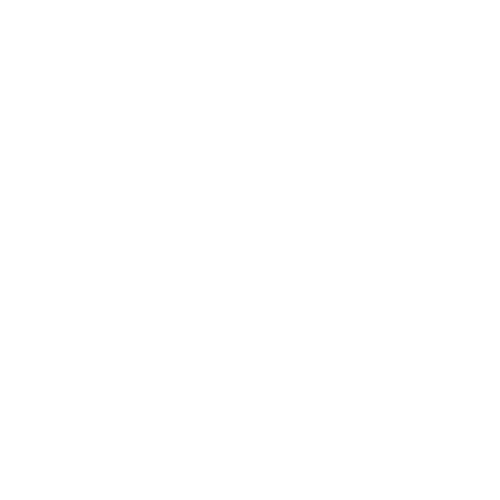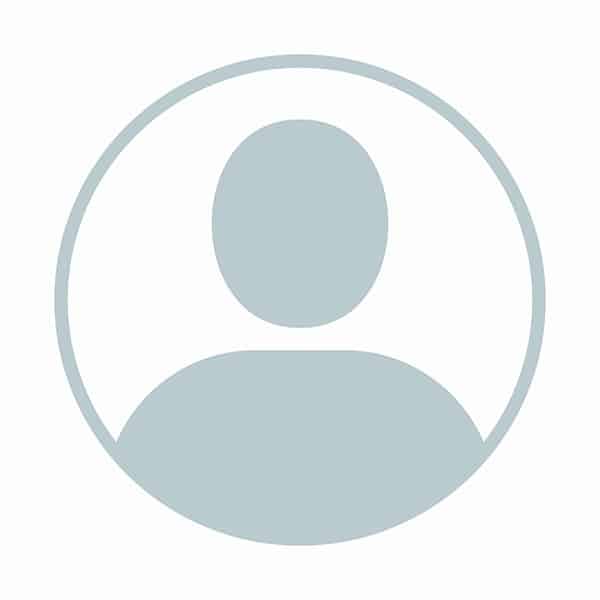On-real

L’ordre négocié et le droit du travail en perspective réaliste
Des réformes visant à promouvoir la négociation collective d’entreprise


Les usages des règles juridiques par les acteurs de la négociation collective
Pour le savoir, il faut examiner, non seulement les espaces ou libertés qu’instituent la loi, mais aussi les conventions et accords collectifs eux-mêmes, tant au niveau de l’entreprise qu’à celui de la branche. C’est, en effet, à travers le prisme de leurs contenus que l’on peut appréhender, avec réalisme, les rapports que ces conventions et accords entretiennent, en appréciant ainsi leur degré de coordination. Ces investigations permettront de saisir le jeu des acteurs de la négociation collective au miroir de ce qu’ils font. Une telle approche du droit (de la négociation collective) « en contexte », en ce qu’elle conduit à valider, à invalider ou à reformuler l’hypothèse d’une décentralisation de la négociation collective en France en prenant appui sur les normes conventionnelles, sera de nature à nourrir, d’un point de vue plus fondamental, la réflexion théorique sur les usages que les acteurs de la négociation font des règles juridiques – outre la question de leur appropriation – ainsi que sur les sources du droit du travail. C’est là une nécessité scientifique, à l’aune des transformations paradigmatiques du droit contemporain, et une impérieuse exigence si l’on entend penser le présent comme l’avenir de notre droit du travail.
Un projet de recherche poursuivant deux objectifs principaux
Ce projet de recherche – juridique mais en perspective interdisciplinaire – poursuit, de la sorte, deux objectifs principaux :
- établir une cartographie réaliste de l’ordre négocié
- élaborer, grâce notamment aux résultats engrangés, une théorie juridique des acteurs du travail.
Le 4 octobre dernier, s’est tenu à la faculté de droit de Montpellier un séminaire organisé dans le cadre du projet de recherche « On-real ». Ce projet, financé par l’ANR et mené par des membres de l’équipe de l’École de droit social de Montpellier (Lucas Bento De Carvalho, Florence Bergeron, Laurianne Enjolras, Arnaud Lucchini et Sophie Selusi) et des membres de l’Institut François Gény de Nancy (Frédéric Géa, Marguerite Kocher, Alexia Gardin et Romain Marié) vise à mesurer les « réalités du dialogue social ». En particulier, il s’agit de vérifier si et dans quelle mesure les négociateurs au niveau de l’entreprise s’émancipent ou pas des stipulations des accords de branche.
Pour ce faire, le séminaire du 4 octobre a donné la parole aux acteurs de la négociation de branche et d’entreprise, qui ont témoigné sur leurs pratiques de négociation. Cette journée très riche a également permis à six étudiants du Master 2 DPRT de Montpellier (Luisa Almeida, Naïssa Antonacos, Stéphane Hoos, Romane Labbaci, Alizée Ogé, Célia Wauquier) de présenter les résultats de leur étude d’accords de branche et d’entreprise portant sur diverses thématiques (travaux insalubres, heures d’équivalence, période d’essai, formation professionnelle, travail intermittent, environnement, indemnités complémentaires en cas de maladie). Ce sont des extraits de leurs interventions que nous vous présentons ici.
Le projet de recherche ANR « Réalités de l’ordre négocié » (ON-REAL, ANR-22-CE53-0004), coordonné par le professeur Frédéric Géa (Université de Lorraine) aux côtés de la professeure Florence Bergeron (Université de Montpellier), poursuit ses travaux initiés en janvier 2023. Les 30 et 31 janvier 2024, une délégation montpelliéraine s’est ainsi déplacée à Nancy pour des séminaires qui ont permis de progresser tant sur le volet théorique ou conceptuel du projet que sur sa dimension analytique, en présence d’une partie des chercheurs impliqués (Lucas Bento de Carvalho, Lauriane Enjolras, Alexia Gardin, Marguerite Kocher, Arnaud Lucchini, Romain Marié, Sophie Selusi, etc., outre les responsables du projet) mais également de doctorants et d’étudiants (de master 2, de l’Université de Montpellier et de l’Université de Lorraine) prenant part à ces travaux, conformément au dispositif prévu.
La première séquence de ce séminaire a permis, le mardi, de déplier la question des « réalités » – au pluriel – de l’ordre négocié, en mettant en discussion les compréhensions ou appréciations dont elle peut faire l’objet, notamment au regard de l’opposition entre les approches quantitative et qualitative ou en considération de grilles de lecture récemment mises en avant. La perspective se voulait, de la sorte, critique (du point de vue théorique). Fut au cœur de cette discussion le concept d’autonomie collective, envisagé sous l’angle du pluralisme juridique. Les réflexions développées il y a un siècle par d’importants auteurs, tels que Georges Gurvitch, ont constitué des points d’ancrage pour un décryptage théorique de certaines tendances et hypothèses que les travaux analytiques portant sur le contenu des accords collectifs ont, dans le cadre de ce projet, fait émerger ou apparaître – en prenant, à maints égards, à rebours les grilles d’analyse usuelles voire dominantes dans le champ disciplinaire du droit.
La seconde séquence, organisée le mercredi, était consacrée à la présentation des investigations approfondies conduites dans le champ des conventions et accords collectifs afin de cerner la nature des rapports qui se nouent – par-delà le prisme du droit étatique – entre les niveaux de négociation de l’entreprise et de la branche. Les travaux, tout à fait remarquables, présentés par des doctorants et des étudiants à travers de multiples entrées thématiques (mesures relatives aux salariés en situation de handicap, QVT, garanties collectives complémentaires, CDD, travail temporaire et contrats de chantier ou d’opération, temps de travail, salariés aidants, GPEC et GEPP, etc.), ont fait ressortir des « réalités » qui restent le plus souvent dans l’angle mort des recherches – et pas uniquement en sciences juridiques. Les éclairages qu’ils ont apportés et les échanges qui les ont suscités ont ainsi permis de nourrir et d’enrichir le volet théorique du projet à partir de son ancrage « empirique ».
Prochain rendez-vous collectif majeur : les 21 et 22 mai 2024, où il s’agira, sous la houlette des professeurs Frédéric Géa, Clémentine Legendre et François Ost, de penser et d’appréhender – en perspective théorique, à la faveur d’une montée en généralité des réflexions – « les usages, fonctions et finalités du droit ».